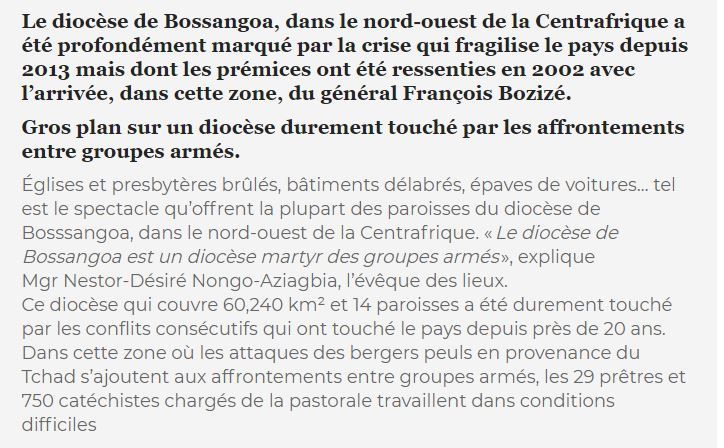Lu pour vous
Lucie Sarr (envoyée spéciale de La Croix Africa), le 16/12/2019 à 16:06
Jusqu’au 19 décembre, le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, effectue une tournée dans le diocèse de Bossangoa, dans le nord-est de la Centrafrique. Dans ce pays plongé, depuis 2013, dans une crise qui peine à trouver des solutions, ses visites pastorales redonnent espoir aux populations.
« Nous comptons sur toi pour aller parler au gouvernement de nos problèmes : nous n’avons ni centre de santé ni eau potable et les groupes armés nous imposent des redevances lorsque nous voulons nous déplacer ». Ce vendredi 13 décembre, à Markounda, le cri du cœur de la responsable des femmes de cette localité centrafricaine, située à la frontière du Tchad, résonne fortement au cours de la réunion publique convoquée par l’archevêque de Bangui.
Comme elle, les 10 000 habitants, ainsi que les autorités administratives, politiques, militaires attendent tous du cardinal Dieudonné Nzapalainga qu’il fasse « quelque chose ». Qu’il parle à la communauté internationale, au gouvernement, aux groupes armés, aux jeunes, qu’il aide telle paroisse…
À 52 ans, Dieudonné Nzapalainga, premier cardinal centrafricain, « Kotoboa » – cardinal en sango, la langue nationale – porte les espoirs de tout un peuple et chacun de ses déplacements provoque des scènes de liesse saisissantes.
« En fait, les politiques ont démissionné dans ce pays. Ils n’osent pas se déplacer de peur de se faire prendre en otage par les groupes armés. Tout le monde se tourne donc vers cette autorité qui tient un discours de vérité parfois au mépris de sa propre vie », explique un élu local qui a requis l’anonymat.
Sollicité par la Conférence épiscopale pour effectuer des visites de proximité aux populations de l’intérieur du pays, l’infatigable religieux de la congrégation du Saint-Esprit a déjà effectué des tournées dans six diocèses. Le 9 décembre, il a repris son bâton de pèlerin pour rencontrer les populations de Bossangoa dans le nord, pendant dix jours.
« Nous comptons sur toi »
Deux jours plus tôt, dans la commune de Nana-Bakassa, dans le même diocèse, ils étaient au moins 5 000 personnes à accueillir le « Kotoboa ». Des centaines de pagnes étaient étendues à même le sol pour guider ses pas vers l’autel improvisé de cette localité très pauvre où l’église a été détruite au plus fort de la crise.
Pendant la messe, au moment de l’offertoire, la foule entonne en sango un chant en l’honneur du « Kotoboa » et défile avec des offrandes : céréales, bananes, haricots, poulets, chevreaux, etc. Pourtant dans cette zone, les groupes armés imposent leur loi, en l’absence de forces de l’ordre et de sécurité, l’eau potable est devenue rare et l’école est presque inexistante.
En outre, la cohabitation entre les confessions religieuses ne va pas de soi. La minorité musulmane ainsi que les chrétiens qui ont collaboré avec la Séléka ont été chassés après la chute, en 2014, de cette coalition majoritairement musulmane. Ils se sont réfugiés, à Kouki, à quelques dizaines de kilomètres de là, où Kotoboa est reçu par les dirigeants des confessions religieuses, quelques heures après Nana-Bakassa. Ici, comme ailleurs, le système éducatif peine à s’organiser : des maîtres-parents (enseignant non qualifiés) tentent d’occuper les enfants pendant la journée en échanges de vivres et la localité n’a pas de maternité.
Groupes armés
« Nous sommes contents que le cardinal vienne ici pour nous rencontrer car c’est un père et il est venu essuyer nos larmes », explique le pasteur de l’Église Lumière à Kouki, porte-parole des responsables religieux. À chacune des étapes de la tournée, les groupes armés sont également conviés. À Kouki, séléka et anti-balaka ne s’étaient pas rencontrés depuis deux ans. « Il y a une méfiance réciproque », précise Stanislas Badjima, 28 ans, commandant de zone chez les anti-balaka. « La crise a causé beaucoup de dégâts, notamment sur les structures sociales et éducatives, nous désirons ardemment le désarmement et nous pensons que le cardinal peut nous aider à cela ».
ENTRETIEN. Cardinal Dieudonné Nzapalainga : « Le conflit en Centrafrique n’est pas religieux »
La Mission de l’ONU en Centrafrique, la Minusca, espère, elle aussi que la médiation du cardinal améliore la situation sécuritaire du pays. « Lorsque l’archevêque de Bangui approche les populations, explique le capitaine Joseph Emmanuel Ekoa. cela permet que les gens cultivent l’esprit d’amour et puissent vivre ensemble. L’Église catholique a un très grand rôle et peut aussi s’adresser aux responsables musulmans. »
---------------------------------------------------------
Défenseur de la paix en Centrafrique
1967. Naît à Bangassou (République centrafricaine).
1997. Prononce ses vœux perpétuels chez les spiritains et est ordonné prêtre l’année suivante.
2009. Administrateur apostolique du diocèse de Bangui puis nommé archevêque en 2012 par Benoît XVI.
2015. Le 19 août, la Plateforme de paix interreligieuse de Centrafrique, qu’il a fondée avec l’imam et le pasteur de Bangui, reçoit le prix Sergio Vieira de Mello.
En novembre, il accueille à Bangui le pape François qui ouvre dans sa cathédrale la première porte sainte du Jubilé de la Miséricorde.
2016. Devient le premier cardinal centrafricain de l’histoire.
Dieudonné Nzapalainga : le combat d'un cardinal pour la paix
http://www.lavie.fr/ Publié le 18/12/2019 à 16h30 - Modifié le 18/12/2019 à 16h58 Laurence Desjoyaux
À Nana-Bakassa, Dieudonné Nzapalainga célèbre la messe sous un soleil déjà haut. Devant l'autel installé sous une simple bâche, il s'adresse à une population prise en otage par un petit groupe d'anti-balaka. Il sait que ces jeunes miliciens justement sont là, fondus dans l'assistance. « La justice se fera, lentement, mais elle se fera, prévient-il. Avant, vous étiez cultivateurs, mais vous avez pris les armes et vous vous dites maintenant colonel ou général. Mais attention, à la prison de Bangui, j'ai vu beaucoup de généraux qui sont désormais rentrés dans le rang ! » Dans son homélie, il exhorte les fidèles à la paix. « Nous prions le Notre Père et nous demandons "Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés". Mais nous qui avons perdu dans cette crise un parent, une maison, sommes-nous prêts à pardonner ?, lance-t-il, ouvrant grands ses bras. Désarmez vos coeurs, et vous aurez la paix ! » Tous comprennent qu'il parle des voisins musulmans, déplacés depuis plus de cinq ans, et que personne ne veut revoir dans ce bourg de brousse. Quand on l'interroge sur cette franchise face aux victimes et aux coupables, qui parfois ne font qu'un, le cardinal confie : « Il faut prendre le taureau par les cornes ! Ici, le rôle des anti-balaka est un sujet tabou. Je démystifie. Parmi eux, certains sont à la croisée des chemins. Je leur tends la main, je leur dis : c'est ton jour de libération ! »
En Centrafrique, l’Église catholique paie le prix fort
Séléka contre anti-balaka
Pendant 10 jours, Dieudonné Nzapalainga est en visite pastorale dans le diocèse de Bossangoa, dans le nord-ouest de la République centrafricaine. La région est lessivée par des années de conflit. En mars 2013, elle a vu arriver les rebelles de la coalition Séléka marchant sur Bangui. Après leur prise du pouvoir, ils reviennent s'installer dans la préfecture de l'Ouham, du nom du fleuve qui traverse Bossangoa, et multiplient les exactions. Le groupe, dont une part importante des membres sont musulmans, s'appuie sur ses coreligionnaires pour son organisation logistique et réduit au silence ceux qui ne courbent pas l'échine. En réaction se forment des milices d'autodéfense, les anti-balaka. « Une confusion s'est installée, associant la Séléka aux musulmans et les anti-balaka aux non-musulmans, chrétiens ou animistes », explique l'évêque Nestor Nongo. Les rouages de la confessionnalisation d'un conflit avant tout politique se mettent en place. Seule l'intervention des forces françaises de l'opération Sangaris permet d'éviter un bain de sang.
Quelques mois plus tard, tous les musulmans, dont beaucoup sont d'origine tchadienne, sont évacués vers le Tchad. Des milliers d'entre eux, souvent Centrafricains, cherchent à se réimplanter dans la région. « Mais il y a une très grande résistance à leur retour, notamment à Bossangoa et à Nana-Bakassa », explique l'évêque. D'autant plus que les groupes armés continuent à tenir le territoire de façon plus ou moins visible et entretiennent l'antagonisme, devenu leur gagne-pain.
Une confusion s'est installée, associant la Séléka aux musulmans et les anti-balaka aux non-musulmans, chrétiens ou animistes.
- Nestor Nongo, évêque de Bossangoa.
Tout l'après-midi, assis à l'ombre des grands arbres à côté de l'église décrépie de Nana-Bakassa, le cardinal réunit tour à tour les responsables religieux chrétiens et protestants - les musulmans n'ont plus mis les pieds dans la ville depuis 2014 -, les Casques bleus de la Minusca et les rares fonctionnaires à ne pas avoir abandonné leur poste. « Ici, il n'y a plus d'État, lance le député de la circonscription. Seule l'Église travaille pour la population. Vous êtes notre porte-voix auprès du gouvernement. » À la nuit tombée, Dieudonné Nzapalainga prend ses notes à la lumière d'une lampe de poche. Il a été opéré cet été et devrait être encore en convalescence, mais il ne ménage pas ses efforts. Après le directeur du collège, c'est le commandant de brigade qui explose. Depuis 2013 et le début de la crise, il est le seul policier ici, sans arme. Il doit faire deux heures de piste pour capter un réseau téléphonique. « Je n'en peux plus, je crois que je vais démissionner », souffle-t-il, au bord des larmes. « Vous êtes un héros, répond le cardinal. Si nous abandonnons, qui viendra ? »
Cardinal et diplomate
Le lendemain, c'est à Kouki, de l'autre côté d'une invisible frontière, qu'il se rend. Cette bourgade est un fief de la Séléka. La réputation du cardinal et l'aura qui l'entoure - certains miliciens le croient même doté de pouvoirs magiques - ont permis de mettre autour de la table deux chefs de groupe antagonistes. Le longiligne « général » Alabib, 49 ans, vêtu d'une djellaba beige, règne sur la Séléka locale. Stanislas Badjima, de 20 ans son cadet, mène 450 anti-balaka. « C'est la première fois que nous nous retrouvons dans la même pièce depuis deux ans », nous explique ce dernier. Dieudonné Nzapalainga va droit au but : « Vous dites vouloir la paix et vous avez signé un accord en 2017, mais qu'en avez-vous fait ? Il faut accepter la libre circulation sur cet axe Kouki-Nana-Bakassa. Là-bas, ils sont prêts à se mettre autour d'une table. Êtes-vous prêts à les rencontrer ? » D'un seul geste, les hommes des deux camps lèvent la main, comme si, en leur ayant exposé la vérité crue, le cardinal les avait libérés. Comment fait-il pour choisir ses mots dans ces moments-là ? « Je prie », répond-il simplement.
Chez les spiritains
Dieudonné Nzapalainga est né le 14 mars 1967 dans un quartier pauvre de Bangassou, dans le sud du pays, « fils de pauvre », cinquième d'une famille de 10 enfants. Sa mère est protestante et il la suit au culte. Vers 8 ans, il se rend à la messe avec son père et ne quitte plus l'Église catholique. Dans la maison familiale se réunissent aussi bien le groupe de la Légion de Marie, auquel appartient son père, que les diaconesses, dont fait partie sa mère. Il tient de son père sa rigueur, et parfois une certaine dureté. Ce dernier, qui ne sait ni lire ni écrire, pousse ses enfants à étudier. « Le soir, même si nous n'avions pas à manger, il achetait le pétrole pour la lampe afin que nous puissions travailler. C'était la priorité. »
Sa rencontre avec un spiritain hollandais, Leon van den Wildenberg, curé de la cathédrale de Bangassou, va changer sa vie. « Il venait manger et jouer avec nous. Il n'était pas au loin, il était proche. Je me suis dit que j'allais faire comme lui. » Pour rentrer au petit séminaire, il doit convaincre son père, qui n'a pas les moyens de payer la scolarité et pense que ce n'est pas pour eux. Dès la deuxième année, c'est lui qui finance ses études en travaillant comme cuisinier ou mécanicien. Toujours sur les traces du père Leon, il entre chez les Spiritains. Il est envoyé en stage dans l'est du Cameroun, où vivent les Pygmées dans des conditions précaires. Il s'y sent tout de suite à l'aise. « Dans ses tournées pastorales aujourd'hui, on retrouve ce charisme d'aller vers les plus abandonnés et de partager leurs souffrances », estime Patrick Mbea, spiritain lui aussi, qui fait partie de l'équipe qui l'accompagne dans tout le pays.
À deux mois de la fin de son stage, le jeune séminariste est convoqué par le supérieur, qui lui annonce qu'il souhaite l'envoyer faire des études en France. C'est ainsi qu'il se retrouve à Clamart, en région...

/image%2F0535055%2F20150103%2Fob_4caa82_carte-centrafrique.JPG)